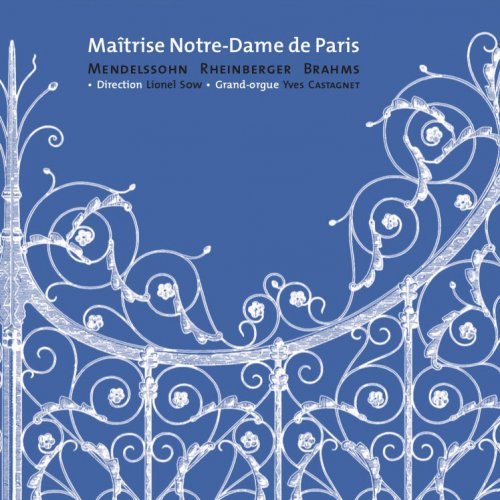Maîtrise Notre-Dame de Paris - Mendelssohn-Rheinberger-Brahms (2010)
BAND/ARTIST: Maîtrise Notre-Dame de Paris
- Title: Mendelssohn-Rheinberger-Brahms
- Year Of Release: 2010
- Label: Musique Sacrée Notre-Dame de Paris
- Genre: Classical
- Quality: FLAC (tracks)
- Total Time: 01:04:23
- Total Size: 291 MB
- WebSite: Album Preview
Tracklist:
01. Felix Mendelssohn
01. Veni Domine, op. 39 n°1 - [04:09]
02. Laudate pueri, op. 39 n°2 - [06:12]
03. Surrexit pastor bonus - Domenica II post Pascha, op. 39 n°3 - [07:53]
04. Josef Rheinberger
Messe en sol mineur, op. 187 -
04. Kyrie - [03:12]
05. Gloria - [03:02]
06. Credo - [05:55]
07. Sanctus, Benedictus - [03:19]
08. Agnus Dei - [03:52]09. Felix Mendelssohn
09. Sonate pour orgue en ré mineur, op. 65 n°6 - [15:36]
10. Johannes Brahms
10. Adoramus, op. 37 n°2 - [02:21]
11. Psaume XIII "Herr, wie lange", op. 27 - [04:54]
12. Ave Maria, op. 12 - [04:05]
01. Felix Mendelssohn
01. Veni Domine, op. 39 n°1 - [04:09]
02. Laudate pueri, op. 39 n°2 - [06:12]
03. Surrexit pastor bonus - Domenica II post Pascha, op. 39 n°3 - [07:53]
04. Josef Rheinberger
Messe en sol mineur, op. 187 -
04. Kyrie - [03:12]
05. Gloria - [03:02]
06. Credo - [05:55]
07. Sanctus, Benedictus - [03:19]
08. Agnus Dei - [03:52]09. Felix Mendelssohn
09. Sonate pour orgue en ré mineur, op. 65 n°6 - [15:36]
10. Johannes Brahms
10. Adoramus, op. 37 n°2 - [02:21]
11. Psaume XIII "Herr, wie lange", op. 27 - [04:54]
12. Ave Maria, op. 12 - [04:05]
On sait avec quel enthousiasme il organisa la première exécution moderne de la Passion selon saint Matthieu, à Berlin, en 1829. Cet événement déclencha un véritable engouement pour la musique chorale, auquel Mendelssohn, mu par une foi luthérienne sereine et profonde, fut le premier à répondre. A sa suite, les musiciens allemands s’adonnèrent tour à tour à cet exercice, encouragés par l’essor de la musicologie, avec l’étude et l’édition systématique des œuvres de Bach, Haendel, Schütz ou Palestrina. Organistes virtuoses comme Mendelssohn le fut lui-même, Brahms et Rheinberger sont certainement, dans la génération suivante, ceux qui lui ont emboîté le pas avec le plus de réussite. Avec ces trois compositeurs se dessine l’image d’une Allemagne pieuse, mais également d’un peuple puisant dans ses racines la force de son renouveau : tout redevables qu’ils soient à la musique du passé, jamais ces compositeurs n’abdiquent leur propre sensibilité, bien de leur temps.
Ce qui les réunit apparaît autant que ce qui les sépare dans ce programme enregistré en concert, et conçu à la manière d’une liturgie : sur l’ossature formée par les pièces du commun – les six mouvements de la messe de Rheinberger – se greffent les motets de Brahms et Mendelssohn correspondant au propre du temps, comme lors d’un office. Yves Castagnet y accompagne la Maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris à l’orgue de chœur, rejoignant le grand orgue, à la tribune, pour la flamboyante Sixième Sonate de Mendelssohn.
Seul compositeur de renom dont puisse s’honorer le Liechtenstein, Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) fut très influent de son vivant, professeur de composition d’Engelbert Humperdinck, Ermanno Wolf-Ferrari et Wilhelm Furtwängler au conservatoire de Munich. Son abondante musique sacrée naquit pour l’essentiel après 1877 et sa nomination comme maître de chapelle et directeur de la musique sacrée à la cour – catholique – de Bavière. Il était en pleine composition de la Messe en sol mineur op. 187, pour chœur de femmes et orgue (1897), lorsqu’il apprit la disparition de Brahms ; il lui dédia la partition « sincere in memoriam ».
La Messe op. 187 est typique de l’art de Rheinberger par sa maîtrise parfaite du contrepoint de Bach (notamment dans le Kyrie et l’Agnus) associée à un lyrisme et à des couleurs harmoniques tout à fait romantiques. Les lignes s’entrecroisent avec une fluidité qui témoigne également de l’admiration de Rheinberger pour Mozart. Numéros séparés, le Sanctus et le Benedictus sont liés par la parenté thématique de leurs sections conclusives, où des lignes ascendantes fusent pour traduire la gloire divine. Le même jeu de retours thématiques, jamais à l’identique, rythme le Credo ; dans ce mouvement, Rheinberger se coule dans une longue tradition rhétorique : la douceur étale illustrant l’Incarnation, le motif chromatique « en croix » de la Crucifixion.
On peut s’étonner de la présence de pages en latin dans l’œuvre de Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), luthérien convaincu : c’est qu’il écrivit ses Trois Motets op. 39 (1830) à Rome, à l’intention des religieuses françaises de la Trinité-des-Monts, dont il avait entendu les voix ravissantes s’échapper sur la place d’Espagne.
Baigné de la même lumière radieuse que la Symphonie italienne, ce triptyque s’ouvre par une page très mendelssohnienne dans son gracieux balancement ternaire et son abondance de tierces et de sixtes. Composé sur un verset alléluiatique du 4e dimanche de l’Avent, ce Veni domine traduit l’attente du Messie : « Viens Seigneur, ne tarde plus, oublie les fautes de ton peuple…
Laudate pueri est en deux volets. Le premier, « Laudate pueri Dominum », verset du samedi de l’Octave pascale, repose sur le Psaume CXIII (CXII dans la numérotation de la Septante) ; la jubilation de la Résurrection se traduit par les imitations, la tonalité solennelle de mi bémol, l’accompagnement en croches volubiles. Le second volet, « Beati omnes », est emprunté au Psaume CXXVIII (CXXVII) : « Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur » ; le ton y est plus intime, avec trois solistes alternant avec le chœur.
Véritable petite cantate composée pour le 2e dimanche de Pâques sur un texte adapté librement des Evangiles et maintes fois mis en musique, Surrexit Pastor bonus (« Il est ressuscité le bon Berger ») est plus redevable à Bach. Le chœur s’y élargit de trois à quatre voix pour affirmer solidement la Résurrection. Puis le duo de sopranos traduit l’affolement des deux Marie (Marie-Madeleine et Marie mère de Jacques et José) découvrant le tombeau vide. Le chœur final, avec ses amples vocalises sur « Alleluia » et son écriture canonique, traduit la joie et l’espérance de la Résurrection.
Mendelssohn joua la musique de Bach dans toute l’Europe, notamment en Angleterre devant un public émerveillé. Il éveilla ainsi l’intérêt de l’éditeur londonien Charles Coventry, directeur de Coventry & Hollier, qui lui commanda la composition de trois voluntaries. Mendelssohn composa en fait, de l’été 1844 au printemps 1845, une série de pièces isolées qu’il baptisa « études » et ne regroupa qu’in extremis pour former six sonates. Envisagées à l’origine comme un ensemble pédagogique, elles déploient un éventail considérable de manières et de climats, tout en se référant à Bach, dans le style (passages fugués) autant que dans la lettre (citations de chorals luthériens). C’est que Mendelssohn place la musique du Cantor comme fondement de toute musique d’orgue future : le vocabulaire et la grammaire indispensables grâce auxquels déployer un style personnel.
Le premier mouvement de la Sixième Sonate est un thème varié sur l’un des plus beaux chorals luthériens, Vater unser im Himmelreich (l’équivalent du Notre Père catholique). Le choral est exposé dans une harmonisation classique à cinq voix. Du dernière accord émerge un mouvement vaporeux de doubles croches, sur une basse chromatique, puis le choral s’élève à la voix supérieure (première variation, Andante sostenuto). Dans la seconde variation, le choral – aux claviers manuels – est contrepointé par les croches légères de la pédale. La troisième variation, plus haletante, présente le thème au ténor ; elle conduit au déferlement des deux dernières variations (Allegro molto), où le choral lutte contre des volées d’arpèges en doubles croches, à la basse puis, dans la variation finale, passant de la basse au soprano ; l’édifice est parachevé par une présentation du choral en majesté, réduit à ses périodes extrêmes.
Le second mouvement est une fugue à quatre voix, dont le puissant sujet dérive de la tête du thème de choral. Comme la Troisième, cette sonate se clôt par un Andante tendre et lyrique, dans la tonalité majeure.
Le 19 mai 1859, à l’occasion d’un mariage, Johannes Brahms (1833-1897) dirigea un chœur de femmes réuni pour l’occasion. Il eut alors l’idée de le pérenniser sous le nom de Hamburger Frauenchor (Chœur de femmes de Hambourg), pour parfaire une expérience de chef de chœur acquise à Detmold depuis deux ans et s’essayer à la composition de nouvelles pièces chorales, aiguillonné par la découverte de maîtres anciens comme Byrd, Caldara, Isaac ou Palestrina. Un concert donné le 9 juin en l’église Saint-Pierre marqua les débuts publics du chœur. On y entendit une page composée l’été précédent, l’Ave Maria op. 12, et une autre écrite expressément, l’Adoremus op. 37 n° 2.
La tonalité de fa majeur et la mesure à 6/8 donnent à l’Ave Maria un caractère pastoral, que renforce la simplicité d’une harmonisation en tierces – Brahms a omis la fin du texte latin, qui parle de péchés et de mort, pour conserver une douceur sans voile. A la fin de l’année, il réalisera une seconde version de l’œuvre, où l’accompagnement d’orgue s’étoffe d’un petit orchestre de bois et cordes.
Deuxième des trois Geistliche Chöre op. 37 [Chœurs sacrés] et seule page a cappella de ce programme, l’Adoremus illustre un texte issu du Chemin de croix (première station). Il imite délibérément le style de Palestrina, dont Brahms avait étudié la Missa Papæ Marcelli trois ans plus tôt ; l’écriture est en canon strict à la quarte, à la quinte et à l’octave, à l’exception des mesures conclusives.
Plus ambitieux, le Psaume XIII op. 27 progresse d’une supplique poignante (« Seigneur, jusqu’à quand m’abandonneras-tu ? ») à l’affirmation d’une espérance sereine. Malgré la modernité de leur harmonie, les deux premières parties et la dernière regardent vers Bach – les trois invocations « Herr » (« Seigneur ») à l’entrée du chœur font irrésistiblement penser à celles qui ouvrent la Passion selon saint Jean. Mais la section centrale « Schaue doch une erhöre mich » (« Regarde-moi donc, et écoute moi ») fait référence à un style plus archaïque, avec ses recto tono et ses quintes à vide. L’orgue est ici très indépendant des voix, portant le grand crescendo final.
Claire Delamarche
Ce qui les réunit apparaît autant que ce qui les sépare dans ce programme enregistré en concert, et conçu à la manière d’une liturgie : sur l’ossature formée par les pièces du commun – les six mouvements de la messe de Rheinberger – se greffent les motets de Brahms et Mendelssohn correspondant au propre du temps, comme lors d’un office. Yves Castagnet y accompagne la Maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris à l’orgue de chœur, rejoignant le grand orgue, à la tribune, pour la flamboyante Sixième Sonate de Mendelssohn.
Seul compositeur de renom dont puisse s’honorer le Liechtenstein, Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) fut très influent de son vivant, professeur de composition d’Engelbert Humperdinck, Ermanno Wolf-Ferrari et Wilhelm Furtwängler au conservatoire de Munich. Son abondante musique sacrée naquit pour l’essentiel après 1877 et sa nomination comme maître de chapelle et directeur de la musique sacrée à la cour – catholique – de Bavière. Il était en pleine composition de la Messe en sol mineur op. 187, pour chœur de femmes et orgue (1897), lorsqu’il apprit la disparition de Brahms ; il lui dédia la partition « sincere in memoriam ».
La Messe op. 187 est typique de l’art de Rheinberger par sa maîtrise parfaite du contrepoint de Bach (notamment dans le Kyrie et l’Agnus) associée à un lyrisme et à des couleurs harmoniques tout à fait romantiques. Les lignes s’entrecroisent avec une fluidité qui témoigne également de l’admiration de Rheinberger pour Mozart. Numéros séparés, le Sanctus et le Benedictus sont liés par la parenté thématique de leurs sections conclusives, où des lignes ascendantes fusent pour traduire la gloire divine. Le même jeu de retours thématiques, jamais à l’identique, rythme le Credo ; dans ce mouvement, Rheinberger se coule dans une longue tradition rhétorique : la douceur étale illustrant l’Incarnation, le motif chromatique « en croix » de la Crucifixion.
On peut s’étonner de la présence de pages en latin dans l’œuvre de Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), luthérien convaincu : c’est qu’il écrivit ses Trois Motets op. 39 (1830) à Rome, à l’intention des religieuses françaises de la Trinité-des-Monts, dont il avait entendu les voix ravissantes s’échapper sur la place d’Espagne.
Baigné de la même lumière radieuse que la Symphonie italienne, ce triptyque s’ouvre par une page très mendelssohnienne dans son gracieux balancement ternaire et son abondance de tierces et de sixtes. Composé sur un verset alléluiatique du 4e dimanche de l’Avent, ce Veni domine traduit l’attente du Messie : « Viens Seigneur, ne tarde plus, oublie les fautes de ton peuple…
Laudate pueri est en deux volets. Le premier, « Laudate pueri Dominum », verset du samedi de l’Octave pascale, repose sur le Psaume CXIII (CXII dans la numérotation de la Septante) ; la jubilation de la Résurrection se traduit par les imitations, la tonalité solennelle de mi bémol, l’accompagnement en croches volubiles. Le second volet, « Beati omnes », est emprunté au Psaume CXXVIII (CXXVII) : « Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur » ; le ton y est plus intime, avec trois solistes alternant avec le chœur.
Véritable petite cantate composée pour le 2e dimanche de Pâques sur un texte adapté librement des Evangiles et maintes fois mis en musique, Surrexit Pastor bonus (« Il est ressuscité le bon Berger ») est plus redevable à Bach. Le chœur s’y élargit de trois à quatre voix pour affirmer solidement la Résurrection. Puis le duo de sopranos traduit l’affolement des deux Marie (Marie-Madeleine et Marie mère de Jacques et José) découvrant le tombeau vide. Le chœur final, avec ses amples vocalises sur « Alleluia » et son écriture canonique, traduit la joie et l’espérance de la Résurrection.
Mendelssohn joua la musique de Bach dans toute l’Europe, notamment en Angleterre devant un public émerveillé. Il éveilla ainsi l’intérêt de l’éditeur londonien Charles Coventry, directeur de Coventry & Hollier, qui lui commanda la composition de trois voluntaries. Mendelssohn composa en fait, de l’été 1844 au printemps 1845, une série de pièces isolées qu’il baptisa « études » et ne regroupa qu’in extremis pour former six sonates. Envisagées à l’origine comme un ensemble pédagogique, elles déploient un éventail considérable de manières et de climats, tout en se référant à Bach, dans le style (passages fugués) autant que dans la lettre (citations de chorals luthériens). C’est que Mendelssohn place la musique du Cantor comme fondement de toute musique d’orgue future : le vocabulaire et la grammaire indispensables grâce auxquels déployer un style personnel.
Le premier mouvement de la Sixième Sonate est un thème varié sur l’un des plus beaux chorals luthériens, Vater unser im Himmelreich (l’équivalent du Notre Père catholique). Le choral est exposé dans une harmonisation classique à cinq voix. Du dernière accord émerge un mouvement vaporeux de doubles croches, sur une basse chromatique, puis le choral s’élève à la voix supérieure (première variation, Andante sostenuto). Dans la seconde variation, le choral – aux claviers manuels – est contrepointé par les croches légères de la pédale. La troisième variation, plus haletante, présente le thème au ténor ; elle conduit au déferlement des deux dernières variations (Allegro molto), où le choral lutte contre des volées d’arpèges en doubles croches, à la basse puis, dans la variation finale, passant de la basse au soprano ; l’édifice est parachevé par une présentation du choral en majesté, réduit à ses périodes extrêmes.
Le second mouvement est une fugue à quatre voix, dont le puissant sujet dérive de la tête du thème de choral. Comme la Troisième, cette sonate se clôt par un Andante tendre et lyrique, dans la tonalité majeure.
Le 19 mai 1859, à l’occasion d’un mariage, Johannes Brahms (1833-1897) dirigea un chœur de femmes réuni pour l’occasion. Il eut alors l’idée de le pérenniser sous le nom de Hamburger Frauenchor (Chœur de femmes de Hambourg), pour parfaire une expérience de chef de chœur acquise à Detmold depuis deux ans et s’essayer à la composition de nouvelles pièces chorales, aiguillonné par la découverte de maîtres anciens comme Byrd, Caldara, Isaac ou Palestrina. Un concert donné le 9 juin en l’église Saint-Pierre marqua les débuts publics du chœur. On y entendit une page composée l’été précédent, l’Ave Maria op. 12, et une autre écrite expressément, l’Adoremus op. 37 n° 2.
La tonalité de fa majeur et la mesure à 6/8 donnent à l’Ave Maria un caractère pastoral, que renforce la simplicité d’une harmonisation en tierces – Brahms a omis la fin du texte latin, qui parle de péchés et de mort, pour conserver une douceur sans voile. A la fin de l’année, il réalisera une seconde version de l’œuvre, où l’accompagnement d’orgue s’étoffe d’un petit orchestre de bois et cordes.
Deuxième des trois Geistliche Chöre op. 37 [Chœurs sacrés] et seule page a cappella de ce programme, l’Adoremus illustre un texte issu du Chemin de croix (première station). Il imite délibérément le style de Palestrina, dont Brahms avait étudié la Missa Papæ Marcelli trois ans plus tôt ; l’écriture est en canon strict à la quarte, à la quinte et à l’octave, à l’exception des mesures conclusives.
Plus ambitieux, le Psaume XIII op. 27 progresse d’une supplique poignante (« Seigneur, jusqu’à quand m’abandonneras-tu ? ») à l’affirmation d’une espérance sereine. Malgré la modernité de leur harmonie, les deux premières parties et la dernière regardent vers Bach – les trois invocations « Herr » (« Seigneur ») à l’entrée du chœur font irrésistiblement penser à celles qui ouvrent la Passion selon saint Jean. Mais la section centrale « Schaue doch une erhöre mich » (« Regarde-moi donc, et écoute moi ») fait référence à un style plus archaïque, avec ses recto tono et ses quintes à vide. L’orgue est ici très indépendant des voix, portant le grand crescendo final.
Claire Delamarche
Download Link Isra.Cloud
Maîtrise Notre-Dame de Paris - Mendelssohn-Rheinberger-Brahms (2010)
My blog
Maîtrise Notre-Dame de Paris - Mendelssohn-Rheinberger-Brahms (2010)
My blog
As a ISRA.CLOUD's PREMIUM member you will have the following benefits:
- Unlimited high speed downloads
- Download directly without waiting time
- Unlimited parallel downloads
- Support for download accelerators
- No advertising
- Resume broken downloads